Mot clé : Conférences
Projection du film SWANBACK de Marija Nemčenko.
Marija Nemčenko est une artiste lituanienne, en ce moment en résidence au Chalet Lecoq dans le cadre du programme AiR de CreArt. CreArt est un réseau de villes européennes pour la création artistique dont la Ville de Clermont-Ferrand est membre.
Une projection de son court-métrage SWANBACK (14 min 30 s) suivie d’une discussion avec le danseur Oliver Connew, protagoniste du film, sera proposée lundi 18 novembre à 18h à l’ÉSACM.
SWANBACK est un film hybride mêlant récits fictionnels et documentaires, et explorant la manière dont, dans les impérialismes britannique et russe, le symbole du cygne a été utilisé pour renforcer les structures d’oppression sur la vie des gens et sur leur corps. Le film met en scène un personnage fictif, interprété par l’ancien danseur de ballet classique Oliver Connew, qui s’inspire en partie d’entretiens avec des membres de la communauté lituanienne qui ont émigré illégalement pour travailler au Royaume-Uni avant que la Lituanie ne rejoigne l’Union européenne en 2004. Le film réagit également à un article tristement célèbre paru dans le journal The Sun en 2003 sur les migrants d’Europe de l’Est, intitulé « Swan Bake : Asylum seekers steal the Queen’s birds for barbecues ». Dans SWANBACK, l’histoire de l’immigrant clandestin se confond avec le parcours de Connew, qui passe du ballet à la danse sémantique. Au lieu de choisir de répondre à la violence du ballet qui altère son corps par la violence de l’amnésie qui altère sa mémoire, il décide d’accepter les cicatrices que le ballet a laissées sur lui.
Produit par Rūta Kiaupaitė, Baltic Productions
Avec Oliver Connew
Directeur de la photographie Nojus Drąsutis
Compositeurs Shakeeb Abu Hamdan et Sholto Dobie
Concepteur du son Kipras Čėsna
Coloriste Justinas Vencius
Monteur Jonas Juškaitis
Marija Nemčenko est une chercheuse lituanienne et une artiste multidisciplinaire dont la pratique s’appuie sur un travail d’archives, de réalisation, d’installation, d’écriture créative et critique, et dont les projets cherche à connecter une approche de l’art socialement engagé à la vie civique. Elle développe actuellement son PhD en recherche-création sur « À la recherche d’alliés : liens géoculturels entre les images en mouvement du CEES et de SWANA ». Ce projet vise à encourager les liens de solidarité régionale non occidentaux par le biais des arts et de la culture. Marija Nemcenko est membre de l’Association lituanienne des artistes interdisciplinaires (LIAA) et de l’Union des artistes écossais, et ½ du collectif BRUT, travaillant dans les domaines de l’art, de l’architecture et de la pratique socialement engagée. Elle a exposé au niveau national et international, notamment à David Dale à Glasgow, au Orlando Museum of Art en Floride, à l’Art Gallery of Alberta à Edmonton, à la Gallerie delle Prigioni à Trévise, à la Glasgow International Biennial à Glasgow, à la Swallow Gallery à Vilnius, à la A.M. Qattan Foundation à Ramallah, en Palestine, et bien d’autres encore.
Oliver Connew est chorégraphe, danseur et écrivain occasionnel, entre autres choses. Il est diplômé en ballet classique de la New Zealand School of Dance et en danse contemporaine d’Unitec Auckland. En 2021, il a suivi le programme Master Exerce de deux ans au Centre Chorégraphique National de Montpellier, en France. Il est formé à l’enseignement du Body-Mind Centering. Depuis 2013, il travaille comme danseur et interprète avec Peter Pleyer, Body Cartography, Wilhelm Groener, Joshua Rutter et July Weber, entre autres. Il est membre de la compagnie de danse berlinoise « Cranky Bodies a/company ». Il vit et travaille à Berlin, en Allemagne.


« Fête de la récolte », un projet dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024
Co-création, durabilité et localité sont au cœur de la Fête de la Récolte, un projet créé et produit lors de la résidence d’artistes NAMAS à Lavaudieu par l’artiste Laura Garbštienė, le duo de commissaires et architectes Jurga Daubaratė et Jonas Žukauskas, ainsi que deux artistes, Andrea Malapert et Ismaël Peltreau, actuellement étudiants à l’ÉSACM.
Ensemble, les artistes et architectes créent une installation artistique sous forme de table de récolte. Cette installation met en valeur la « récolte » comme vecteur de connexion entre les paysans, les artisans et les artistes. Le processus de création inclut des rencontres avec les agriculteurs et artisans locaux, la participation à des entraides, la collecte et l’utilisation de matériaux locaux tels que le bois, ainsi que l’intégration de pièces faites à la main, afin de souligner l’énergie et le temps que requiert le travail manuel.
Durant l’été 2024, une première phase de rencontres a eu lieu en Haute-Loire et en Lituanie.
Du 16 septembre au 31 octobre 2024, le projet prend forme avec une période de création collaborative à Lavaudieu, au sein de la résidence d’artistes NAMAS dirigée par Neringa Greiciute, avec des phases de production dans les ateliers fournis par l’ÉSACM.
Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024, le projet « Fête de la Récolte » est soutenu par la résidence d’artistes NAMAS, située à Lavaudieu (43), la résidence Verpejos située à Kabeliai, en Lituanie, et l’ÉSACM.
———————————————————————————–
PROGRAMME
→ Portes ouvertes de NAMAS, le dimanche 13 octobre entre 16h et 20h, à Lavaudieu.
→ Conférence publique, le jeudi 17 octobre à 17h30, à l’ÉSACM.
Laura Garbštienė, Jurga Daubaratė et Jonas Žukauskas, artistes et architectes litunaniens résident·es à NAMAS, présenteront leurs pratiques lors d’une conférence publique dans l’amphithéâtre de l’ÉSACM.
→ Exposition/restitution, vendredi 25 octobre, à 18h à Clermont-Ferrand, dans le Grand Atelier de l’ÉSACM. Puis visible depuis la rue Kessler, dans la coursive de l’ÉSACM du 29 octobre au 28 novembre.
La création d’une table réalisée à partir de bois collecté localement invitera à se retrouver physiquement et symboliquement autour des produits de la « récolte créative » issue du travail artistique, agricole et artisanal lors d’un temps de restitution ouvert à tous·tes.
————————————————————————————
La Saison de la Lituanie en France – du 12 septembre au 12 décembre 2024
Née d’un partenariat entre les deux pays, cet événement présente la Lituanie contemporaine et sa culture au public français sous diverses formes : performances, expositions, spectacles, projections, débats, conférences et gastronomie. Avec plus de mille ans d’histoire, après avoir surmonté de nombreux défis, la Lituanie a su préserver l’une des langues les plus anciennes du monde et évoluer vers un pays moderne et créatif d’Europe du Nord. Aujourd’hui, elle est un membre actif et engagé de l’UE, de l’OTAN et de l’OCDE.
Le programme de la Saison est avant tout une invitation à se voir en l’autre, car, comme l’écrit le philosophe Viktoras Bachmetjevas : « l’autre est toujours différent, mais jamais complètement autre ». Il vise également à initier des collaborations à long terme entre les institutions et créateurs lituaniens et leurs partenaires français.
La « Fête de la Récolte » contribue à poser les jalons d’une coopération entre NAMAS, Verpejos et l’ÉSACM dans le développement conjoint de programmes d’échange de résidences et dans le renforcement de leur ouverture internationale.
Pour en savoir plus sur la Saison de la Lituanie en France et découvrir l’ensemble de la programmation, visitez : https://saisonlituanie.com.
Jurga Daubaraitė et Jonas Žukauskas sont des chercheurs et commissaires d’exposition basés à Vilnius. Ils ont cofondé la maison d’édition Kirvarpa, la plateforme Neringa Forest Architecture et l’agence d’architecture Talka talka. Ils ont co-commissarié de nombreuses expositions, dont le Children’s Forest Pavilion et le Baltic Pavilion respectivement à la Biennale d’architecture de Venise en 2023 et 2016.
Laura Garbštienė concentre sa pratique récente sur des formes d’art temporaires et des réflexions sur les phénomènes naturels, la conscience écologique, la domesticité et le déclin de la vie rurale. Depuis 2013, Garbštienė vit à Šklėriai, un petit village près du parc national de Dzūkija, avec un petit troupeau de moutons Skudde, où elle promeut le filage comme un mouvement anti-capitaliste pour unir des personnes issues de divers horizons culturels. En 2017, elle a lancé Verpėjos (Les Fileuses) – une initiative gérée par des artistes pour étudier et discuter du mode de vie rural traditionnel et de la préservation de la nature à l’échelle locale et mondiale. Ses œuvres ont été exposées au Centre d’Art Contemporain, à la Galerie Nationale d’Art et à la Galerie VARTAI à Vilnius ; à la Biennale Rauma Balticum en Finlande (2004) ; à la Biennale de Prague (2007) ; à la Biennale de Liverpool (2010) ; et au Musée de la Photographie de Séoul (2021). The Film About an Unknown Artist (2009) a reçu une mention spéciale par un jury international et le Prix de la Critique Internationale (Prix FIPRESCI) au Festival International du Court Métrage d’Oberhausen. Les œuvres de Garbštienė font partie de diverses collections en Lituanie et à l’étranger.
Andrea Malapert, vit à Clermont-Ferrand et étudie en cinquième année à l’école d’art de Clermont Métropole. Son travail se situe à la lisière du sensible et de l’intelligible, une sensorialité douce qui s’expérimente sur la matière par sa transmutation alchimico-poétique pour lui trouver une existence qui affleure la perception. Elle manipule principalement le papier, l’installation, l’édition, le dessin, l’écriture, l’installation sonore et la céramique.L’année dernière, elle a exposé une pièce en collaboration avec son frère dans l’exposition collective à côté de, à In Extenso, Clermont-Ferrand.
Ismaël Peltreau Tapin est actuellement en cinquième année à l’école supérieure d’art de clermont métropole. Il mêle sa vie à ses sujets de travail pour les rendre plus tangibles. Il part de situations précises pour aborder des concepts universels. Il réalise des expéditions artistiques qu’il donne ensuite à voir dans la forme qui lui permet de témoigner au mieux de son expérience.
Neringa Greiciute est photographe, travaillant entre la Lituanie et la France. Depuis 2022, elle dirige la résidence d’artistes NAMAS à Lavaudieu.
Pour en savoir plus sur la Saison de la Lituanie en France et découvrir l’ensemble de la programmation : https://saisonlituanie.com
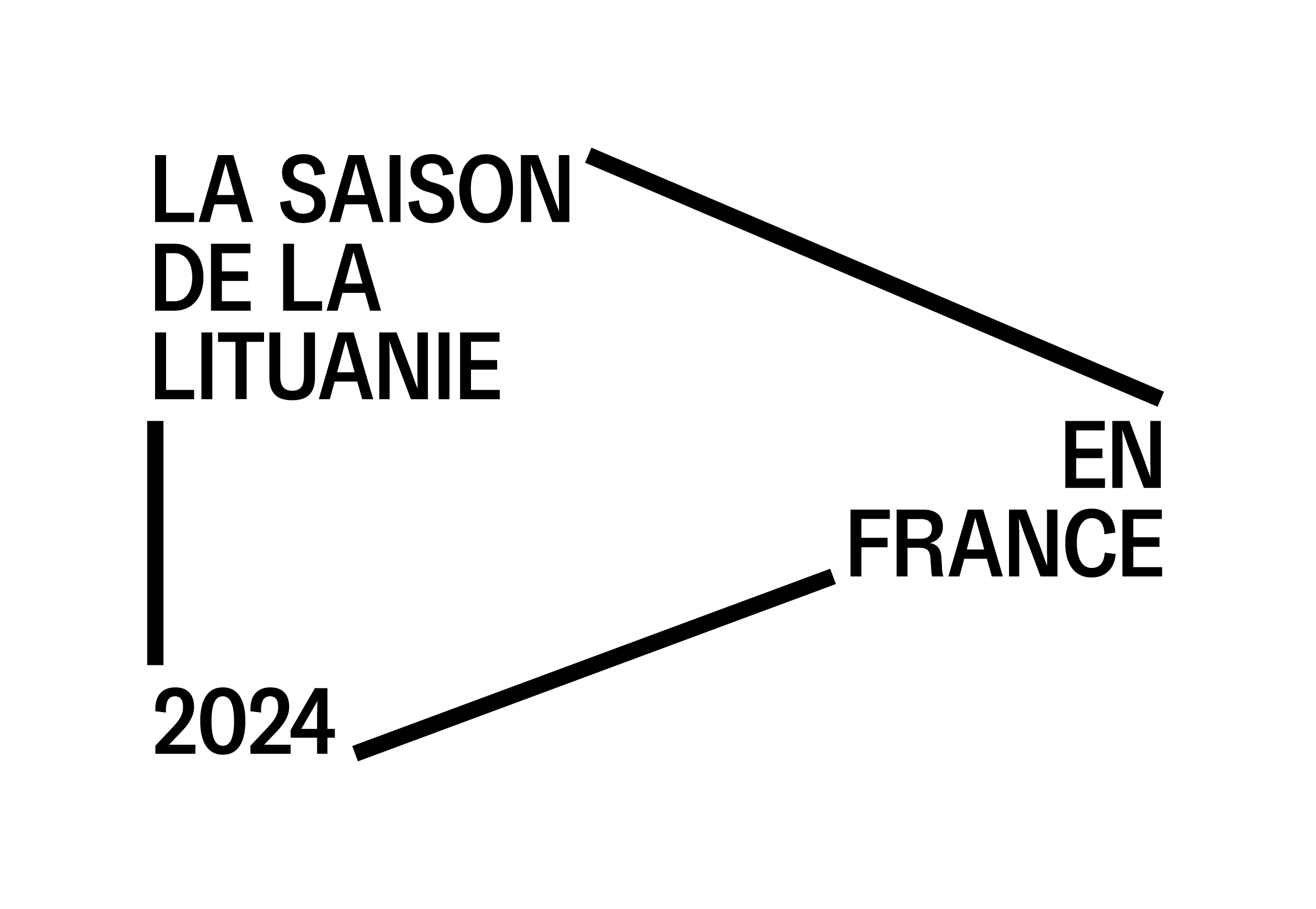

Restitution publique du focus « Projet extérieur / Live »
Le focus « Projet extérieur / live » propose une restitution de résidence, avec les étudiant.e.s Marjolaine Müller, Ismaël Peltreau & Elena Malakhova, Yombo Bahonda & Wilma Burguière.
Une soirée de performances publique qui aura lieu mercredi 29 mai 2024 au Lieu-Dit (rue Fontgiève) à 18h00.
Conférence de l’écrivaine Zoé Cosson
Depuis 2011, l’ÉSACM accueille avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, un·e écrivain·e en résidence afin de soutenir la place importante que l’école souhaite donner à l’écriture et à la littérature dans son projet. Il s’agit d’une résidence de création au cours de laquelle, l’écrivain·e intervient ponctuellement auprès des étudiant·es. En 2024, l’ÉSACM accueille Zoé Cosson.
Née en 1995, Zoé Cosson est autrice et vidéaste. Après l’obtention d’un DNSEP à l’ESAD de Reims, elle intègre le Master de Création Littéraire du Havre où son goût pour l’investigation sensible, le montage cinématographique et la marche en montagne nourrissent l’écriture d’un manuscrit ancré dans les Pyrénées ariégeoises. Aulus, son premier roman est publié dans la collection l’Arbalète aux Editions Gallimard en 2021.
Elle a contribué à la plateforme éditoriale Switch (on Paper), à la revue Artichaut, a travaillé en collaboration avec des artistes plasticiens mais aussi avec la société de production Capricci. Son travail, intimement lié à des terrains de recherche circonscrits, se déploie dans le cadre de résidences immersives : au Centre de Cosmologie de Paris, à Providenza en Corse ou encore à Ota pour Création en cours avec les Ateliers Médicis. En 2023, elle intègre le parcours d’incubation PAGE lancé par l’agence Normandie livre et lecture. Elle est lauréate du Prix de soutien à la Création Littéraire de la fondation Simone del Duca et de l’appel à projets pour une résidence de création à destination des auteur·rices émergent·es proposée par la Collectivité de Corse et La Marelle. Actuellement, elle travaille sur l’écriture de La Vitesse de fuite (titre provisoire), son deuxième roman.
« En chinois, il n’existe pas de mot pour dire « paysage ». On dit : « vent-lumière », impliquant de cette façon les éléments, leurs mouvements et leurs inconstances. En tant qu’autrice je m’intéresse à cette manière d’appréhender un territoire avec les forces motrices qui l’habitent : le vent, l’eau, les corps debout ou « êtres-paysages », la flore, la langue. Je ne crois pas à la définition du paysage, mutilante, qui renvoie à une perception sans oreille, sans peau et sans histoire d’une « nature » qui serait extérieure à l’homme. Je crois plutôt que le paysage est une construction intime, un ensemble d’images et de sensations recomposées après-coup à partir de notre expérience. Je crois, comme l’écrit le jardinier Gilles Clément que : « Le paysage est ce que l’on voit après avoir cessé de l’observer. »
Mon travail part de ce postulat et d’une topophilie toute personnelle. L’écriture creuse ce qui me reste d’un lieu une fois que j’en suis arrachée, avec ses spécificités qui en font un sujet contemporain. Je ne choisis pas ces lieux, d’une certaine manière ils s’imposent à moi. Ce sont des lieux polymorphes et montagneux, composés d’une histoire passée et présente complexe, de géographie, de botanique, de relations humaines et d’archives, de souvenirs, d’anecdotes, d’affaires politiques et intimes, écologiques, de récits captés in situ, de toute une matière hybride et de ce que ma mémoire en garde. »
Conférence de l’écrivaine Emmanuelle PIREYRE
Journée d’étude « Recherche et création » avec l’UCA
Le lundi 12 février, l’Université Clermont Auvergne et l’ÉSACM s’associent pour la journée d’étude « Recherche et création ». À cette occasion, l’ÉSACM accueillera l’écrivaine Emmanuelle PIREYRE pour une conférence ouverte à tou·tes, dans l’amphithéâtre, à partir de 16h.
Conférence de David Hartt
Dans le cadre d’un partenariat avec la Villa Albertine, 6 écoles supérieures d’art et de design accueilleront David Hartt en résidence pédagogique et de création. L’artiste canadien proposera un workshop à l’ÉSACM du 20 au 24 novembre 2023, et donnera une conférence publique le 20 novembre 2023 à 17h30.
David Hartt propose aux écoles d’art et design françaises de travailler à partir du concept qu’il nomme Terraforming, une analyse de la façon dont le paysage est constamment façonné pour refléter des valeurs culturelles différentes et concurrentes.
Image : Installation view of The Histories (Crépuscule) in New Grit: Art & Philly Now, The Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA, 2021
Table ronde « Faire écosystème : les acteurs culturels, accélérateurs des dynamiques de transitions territoriales »
Un évènement proposé en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Clermont Massif Central, dans le cadre de la 44e journée nationale des agences d’urbanisme intitulée « No cultures no futures » qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2023.
Cette table ronde proposée le jeudi 16 novembre à 14h45 permettra les échanges entre Amélie Sounalet, coordinatrice du Pôle éducation artistique et culturelle de l’ÉSACM et Nathalie Miel, directrice du DAMIER.
Le programme complet de ces journées ici.
Évènement sur inscription : https://aucm.fr/inscription-fnau44/
———————–
Au déni succède le vertige. Au refus de voir le monde s’effondrer – avec un climat qui s’emballe, le vivant qui s’étiole, des ressources qui s’épuisent et des inégalités qui se creusent – s’ensuit la désorientation. Redevenue vulnérable et privée des repères forgés par la modernité, l’humanité va devoir réinventer ses manières de vivre sur terre.
Le changement global n’est pas une crise passagère. Des ajustements techniques, économiques ou sociaux isolés ne suffiront pas à retrouver « les équilibres d’antan » comme les discours sur les transitions et la résilience le laissent parfois supposer. La situation est vertigineuse parce que la réorientation écologique indispensable pour sauver l’habitation humaine de la planète promet d’être un moment historique de reconception des mondes et de réinvention de nos territoires.
C’est une profonde recomposition culturelle qu’il faut engager, si l’on entend par culture, l’ensemble des représentations et des récits, des codes et des pratiques, des valeurs et des attachements qui lient les collectifs humains à leurs milieux de vie. Cette recomposition culturelle est heureusement déjà perceptible si l’on prête attention à ses signaux faibles en matière d’agriculture, d’alimentation, de production, d’énergie, d’habitat, de mobilité, d’aménagement et d’urbanisme, de démocratie, de relations au vivant, etc.
Du côté des sciences et de l’art, ce sont de nouvelles pensées, de nouveaux savoirs, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, de nouvelles sensibilités, de nouvelles émotions, de nouvelles relations entre humains, mais aussi non humains, de nouvelles expériences de vie et de cohabitation qui sont mises en scène. D’aucuns n’hésitent pas à parler de véritable Renaissance.
L’objet de cette 44e Rencontre des agences d’urbanisme est d’aborder la réorientation écologique des territoires au travers de cette recomposition culturelle. Pendant trois jours, du mercredi 15 au vendredi 17 novembre 2023, la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale sera notre refuge pour écouter, apprendre et discuter, pour enquêter, expérimenter et atterrir, pour partager et nous émouvoir, littéralement « nous mettre en mouvement ». Conférences, débats, performances, expositions, explorations, dégustations, danse : c’est à une joyeuse expérience d’émulation « punk » et de co-habitation anthropocène au cœur du Massif central que nous vous convions.
Conférence Rosanna Puyol
Rosanna Puyol est poétesse, éditrice et collabore avec des artistes pour des expositions, programmes de vidéo ou performance. Co-fondatrice des éditions Brook, elle publie des traductions de livres engagés dans des luttes féministes et antiracistes, une littérature tant poétique que chercheuse sous la forme d’essais, de manifestes, de poèmes et critiques d’art. Rosanna organise aussi, souvent avec des amixes, des groupes de lecture et de traduction.
Avec Brook, elle a publié par exemple des textes de José Esteban Muñoz, Laura Mulvey, Shulamith Firestone. Elle a coordonné, aux côtés de Léna Monnier et Sandar Tun Tun, les ateliers de traduction du livre de Fred Moten et Stefano Harney The Undercommons, et collabore aujourd’hui avec Pauline L. Boulba, Aminata Labor et Nina Kennel pour la réalisation d’un livre autour de la critique de danse et militante lesbienne Jill Johnston.
Son premier recueil, D’l’or, est à paraître chez After 8 books. A thing conducting a été publié par Publication Studio et on peut lire d’autres poèmes dans les revues Mouvement, Dispersantxes et C’est les vacances (à paraître).
Cette conférence sera l’occasion d’aborder différents travaux de traduction collective, dont Les sous-communs, planification fugitive et étude noire de Fred Moten & Stefano Harney ; le lien entre traduction, collaboration et écriture poétique ; le travail dans l’amitié ou l’amitié dans le travail ; la création d’une maison d’édition comme lieu de travail et cadre économique. Aussi de lire des poèmes.
Gratuit et ouvert à tou·tes
Conférence débat « Quelle retraite pour les artistes ? »
Une proposition dans le cadre du cycle « Travailler dans le champ de la création » mis en place par l’ÉSACM, Culture en Danger 63, et le Conseil Départemental du Puy de Dôme.
Si la question des retraites renvoie à des enjeux essentiels à l’échelle individuelle, elle est aussi révélatrice d’un certain modèle de société et de la place qui est donnée à la solidarité. Malgré l’importance de ces enjeux, la question des retraites reste pour beaucoup aujourd’hui insaisissable. La force des mobilisations collectives et les antagonismes politiques provoqués par les projets de réforme successifs mettent périodiquement en lumière certains aspects de cette question complexe. La retraite c’est un temps social – la fin de la vie active – mais c’est aussi une somme monétaire – la pension – dont le versement, au moment de la fin de vie active, est servie par au moins deux régimes : l’un de base et l’autre complémentaire. Voilà une première définition sur le papier, dans les faits c’est plus complexe car les concepts manquent pour accéder à une compréhension systémique du rôle de ce dispositif dans la régulation des vies individuelles dans les sociétés occidentales. Aussi l’ÉSACM et l’association Culture en danger 63 invitent la sociologue Marion Arnaud à faire le point sur la retraite des artistes-auteur·rices. À quoi ressemble le système de retraite des artistes-auteur·rices en 2023 ? D’où vient-il, comment fonctionne-t-il ? À quels dysfonctionnements est-il actuellement confronté ? Quels sont les impacts du projet de réforme ? À quelles difficultés font face les artistes-auteur·rices quand il s’agit de prendre connaissance de leurs droits à la retraite ? Les réponses apportées à ces questions permettront d’accéder à une représentation plus claire de ce système dans le contexte social actuel. Cette intervention permettra également d’apporter des ressources aux artistes-auteur·rices en prise avec des difficultés, souvent angoissantes, dans la préparation de leur retraite et dans leurs démarches auprès des organismes collecteurs.
Intervenant·es : Marion Arnaud est sociologue (EHESS/CMH-INèS), spécialiste des retraites. Elle est l’autrice de La Préfon, une sociohistoire de la capitalisation dans le système français de retraite et elle termine une thèse proposant une analyse compréhensive des inégalités de pensions en France. Pour Culture en danger 63 et pour l’ÉSCAM, elle propose de livrer une analyse à la fois sociologique et politique de la retraite des artistes-auteur·rices.
→ Lundi 24 avril 2023, 17h30-19h30
Le Lieu-Dit, 10 rue Fontgiève 63000 Clermont-Ferrand
Entrée libre












